Tebboune à Rome : une phase charnière dans la relation entre l’Algérie et l’UE
Par Sid-Ali Mokhefi – Le sommet bilatéral prévu à Rome le 23 juillet s’annonce comme un moment charnière dans la relation entre l’Algérie et ses partenaires européens. Au-delà des thématiques affichées – énergie, logistique, agro-industrie –, c’est un nouvel équilibre qui se joue. Car le contexte mondial ne laisse plus place aux ambiguïtés : les anciens schémas s’effondrent, et l’Algérie apparaît aujourd’hui comme un acteur central dans la recomposition méditerranéenne.
L’Europe, fragilisée par la baisse des flux russes, les tensions sur le marché du GNL et la pression de la transition énergétique, cherche désespérément des garanties. L’Algérie, elle, avance avec prudence mais fermeté. Elle ne revendique pas de statut, elle l’incarne : celui d’un pivot énergétique, logistique et stratégique. Non plus un simple fournisseur, mais un partenaire incontournable.
Longtemps cantonnée au rôle de réservoir fossile, l’Algérie impose désormais une approche nouvelle : les grands projets devront intégrer des retombées concrètes sur le sol national. Transferts industriels, création d’emplois locaux, co-investissements structurants – il ne s’agit plus de signer des accords symboliques, mais de construire des chaînes de valeur partagées et durables.
Ce sommet ne peut être une simple séquence diplomatique de plus. Il est l’occasion d’un repositionnement clair. Soit l’Europe comprend que le partenariat avec l’Algérie exige respect mutuel et engagement réel, soit elle répète les erreurs du passé, au risque de voir d’autres puissances prendre la relève. Car, dans un monde en bascule, l’Algérie a désormais le choix de ses alliances.
Le réalisme italien, les besoins énergétiques allemands, les incertitudes françaises : Alger peut, avec lucidité, jouer les lignes de fracture pour renforcer ses marges. Mais cela suppose de sortir de la diplomatie conciliante. De parler d’égal à égal. D’exiger que chaque engagement tienne ses promesses.
Car l’Algérie n’est plus une variable d’ajustement. Elle se transforme en profondeur : diversification économique, transition numérique, montée en puissance logistique, ambitions africaines affirmées. Elle propose une main tendue, mais une main ferme.
Ce qui se décidera à Rome engage bien plus qu’un partenariat bilatéral. C’est la place de l’Algérie dans l’architecture future de la Méditerranée qui se dessine. Et, avec elle, une certaine idée de la souveraineté économique, de la dignité dans les relations internationales et de la capacité des nations du Sud à imposer leur rythme.
S.-A. M.







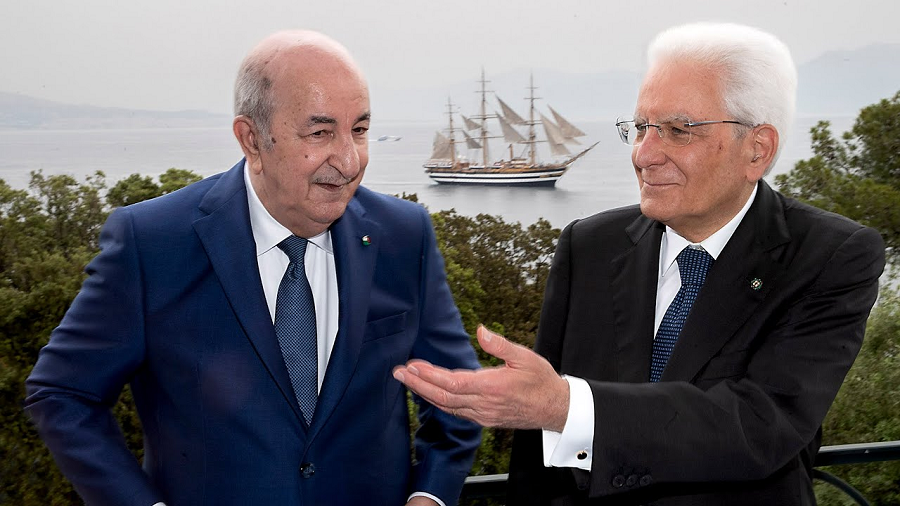








Comment (5)