Le fauteur de trouble Bruno Retailleau : ce flic qui se prend pour la République
Par A. Boumezrag – Au printemps 2025, alors que le monde s’emballe autour des grandes crises climatiques, énergétiques et géopolitiques, la France semble suspendue dans un éternel retour du passé. Et dans ce décor où tout devrait s’accélérer, un homme s’impose comme un gardien zélé – ou un fauteur de trouble obsessionnel : Bruno Retailleau.
Non content d’être un sénateur parmi tant d’autres, Retailleau incarne ce personnage politique qui ne cesse de confondre autorité et autoritarisme, contrôle et coercition, patriotisme et xénophobie larvée. C’est, en quelque sorte, le flic de la République, celui qui croit que pour défendre la nation, il faut d’abord surveiller, intimider et maintenir sous tutelle tous ceux qui dévient du dogme nationaliste à la française.
La France en clair-obscur : quand la République se fait garde-chiourme
Retailleau ne représente pas seulement une tendance politique. Il est le symptôme d’une France fracturée, rongée par ses doutes et ses complexes, surtout lorsqu’il s’agit de regarder son passé colonial en face. L’Algérie, ce pays frère devenu distant, est pour lui une plaie ouverte, un abcès que l’on gratte sans jamais vraiment panser.
Dans ce printemps 2025 marqué par des escalades diplomatiques sur la mémoire coloniale, les questions migratoires et des coopérations économiques en berne, Retailleau joue son rôle à la perfection : il réactive les rancunes, attise les haines, exacerbe les blessures.
A travers ses propos souvent maladroits, voire volontairement provocateurs, il ne cherche pas à bâtir un pont. Il se pose en gardien d’un ordre immobile, en rempart contre ce qu’il perçoit comme une remise en cause de l’identité française. En réalité, il est un monstre du passé qui surgit dans ce chaos organisé, un fantôme qui refuse de laisser place à la lumière.
Algérie-France : une relation fracturée, manipulée et surjouée
Du côté algérien, la réaction est mesurée, mais ferme. Ce n’est pas une riposte frénétique, mais un rappel constant que le passé colonial n’est pas un simple sujet de débat historique, mais une blessure vivante. L’Algérie dispose d’une mémoire collective robuste, utilisée aussi comme levier politique. Chaque maladresse française, chaque sortie à la Retailleau est pour elle un catalyseur diplomatique, une occasion de resserrer les rangs nationaux autour d’un récit de résistance et d’indépendance retrouvée.
Cette posture, loin d’être un hasard, s’inscrit dans un jeu diplomatique subtil où la mémoire et la souveraineté deviennent des armes. L’Algérie sait que la France est fragile, tiraillée entre sa grandeur passée et une modernité incertaine. Elle exploite cette faiblesse, sans jamais la brutaliser – elle sait que le temps travaille pour elle.
Macron : le funambule d’une République en équilibre précaire
Au cœur de ce clair-obscur diplomatique, Emmanuel Macron joue le rôle du funambule sur un fil tendu entre la mémoire et la modernité, entre la fermeté et le dialogue, entre la France d’hier et celle de demain.
Contrairement à Retailleau, qui se drape dans un autoritarisme passéiste, Macron essaie – parfois maladroitement – de composer avec cette complexité. Sa politique envers l’Algérie oscille entre appels à la réconciliation et gestes symboliques, sans jamais vraiment rompre avec le poids historique qui pèse sur les relations bilatérales.
Mais cette posture est fragile. Macron doit naviguer entre les lignes des ultras français nostalgiques, des jeunes générations franco-algériennes en quête de reconnaissance et d’un pouvoir algérien lui-même en mutation. Chaque maladresse est scrutée, chaque mot pesé, dans un contexte où les passions sont vives.
En somme, Macron est le chef d’orchestre d’une partition inachevée, conscient que la République qu’il incarne est tiraillée. Sa tâche est de trouver un équilibre, d’empêcher que les Retailleau de tous bords ne fassent exploser ce fragile édifice.
Macron et l’effondrement à petit feu : chef d’orchestre ou simple spectateur ?
Emmanuel Macron, chantre d’une modernité libérale et d’une Europe forte, se retrouve pourtant au cœur d’un paradoxe saisissant : celui d’un édifice français vieux de mille ans qui vacille, fissuré de toutes parts. Sa présidence, souvent qualifiée de «jupitérienne», a voulu incarner une République forte, centralisée, rationnelle – mais elle a aussi exacerbé les fractures sociales, culturelles et identitaires qui traversent le pays.
Face à la montée des populismes, au rejet grandissant des élites, à la crise des banlieues et à la question brûlante des mémoires coloniales, Macron est resté souvent un funambule trop prudent : ni assez ferme pour imposer une réforme claire, ni assez audacieux pour réconcilier vraiment les Français avec eux-mêmes.
Dans le dossier franco-algérien, cette hésitation a permis aux Retailleau et autres ultras de prospérer. Macron a préféré le pragmatisme au combat des idées, la diplomatie au courage politique. Résultat ? Un terrain vague où le passé colonial redevient un champ de bataille idéologique et où la République semble de plus en plus une idée fragile, qu’un «flic» zélé croit pouvoir incarner à lui seul.
Si l’édifice français s’effondre, ce n’est pas seulement sous les coups des extrêmes, mais aussi sous le poids d’une gouvernance qui, faute de vision claire, laisse la forteresse se fissurer.
Un théâtre d’ombres et de lumières
Le tableau est clair-obscur : d’un côté, une France qui s’enferme dans ses peurs identitaires, incarnées par Retailleau et ses semblables ; de l’autre, une Algérie qui capitalise sur cette fermeture pour affirmer son récit national. Entre les deux, un peuple franco-algérien souvent oublié, qui regarde ce bras de fer avec scepticisme, fatigue, parfois colère.
Retailleau est utile à l’Algérie. Parce qu’il lui rappelle qu’en face la France n’a pas tourné la page. Il est un miroir cassé dans lequel elle voit une République en crise, obsédée par ses blessures anciennes.
Inversement, l’Algérie est utile à Retailleau : elle est la cause parfaite pour justifier sa posture intransigeante, son obsession du passé, et son rôle de flic autoproclamé de la morale nationale.
La tragédie est simple : Retailleau se croit la République, mais il n’est qu’un symptôme de sa crise. Un symptôme corrosif, qui gangrène la confiance entre deux peuples liés par l’histoire, l’espace, et parfois la douleur.
Retailleau joue au flic de la République, mais oublie que celle-ci est une idée, pas une autoroute à péage pour ses certitudes.
Cette chronique dépeint un printemps 2025 où l’histoire continue de s’inviter dans la politique, où les monstres du passé surgissent dans le chaos organisé des enjeux contemporains, et où la France et l’Algérie restent prisonnières d’un clair-obscur, incapables de bâtir la lumière.
A. B.










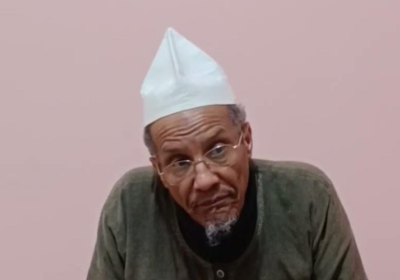





Comment (14)